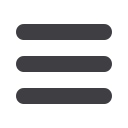Alchimie
65
constituer un véritable modèle scientifique et rigoureux à opposer aux interpré-
tations abusives et partielles, hélas très répandues, issues d’un hermétisme éso-
térique, illuminé et charlatanesque.
Cristina Viano
➤➤
Archéologie, historiographie
mots-clés
Alchimie, Alexandrie, Égypte, imitation, recettes, transmutation
Références
Berthelot, Marcelin et Ruelle, Charles-Émile,
Collection des anciens alchimistes grecs
,
Paris, 1888‑1889 (réimpr. Osnabrück, 1967).
Colinet, Andrée,
Les Alchimistes grecs
, X :
Anonyme de Zuretti
, Les Belles Lettres, Paris,
2000.
Colinet, Andrée,
Les Alchimistes grecs
, XI :
Recettes alchimiques (Par. Gr. 2419 ;
Holkhamicus 109)
,
Cosmas le Hiéromoine – Chrysopée
, Les Belles Lettres, Paris, 2010.
Festugière, André-Jean,
La Révélation d’Hermès Trismégiste
. I :
L’Astrologie et les Sciences
occultes
, Les Belles Lettres, Paris, 1944.
Halleux, Robert (éd.),
Les Alchimistes grecs
, I :
Papyrus de Leyde, Papyrus de Stockholm,
Fragments de recettes
, Les Belles Lettres, Paris, 1981.
Mertens, Michèle,
Les Alchimistes grecs
, IV :
Zosime de Panopolis, Mémoires authentiques
,
Les Belles Lettres, Paris, 1995.
Needham, Joseph,
Science and Civilisation in China
, V, 2, Cambridge University Press,
Cambridge, 1974.
Viano, Cristina (éd.),
L’Alchimie et ses racines philosophiques
, Vrin, Paris, 2005.
Moyen Âge
L’alchimie arabe
Les traductions arabes du grec et du syriaque et l’assimilation
Les premières traces de l’alchimie dans le monde arabe semblent remonter au
viii
e
siècle et, de manière plus certaine, au début du ix
e
siècle, accompagnant le
mouvement des traductions du grec et du syriaque vers l’arabe qui fleurit sous
le califat d’al-Ma’mûn (mort en 833). Toutefois, l’état actuel des recherches dans