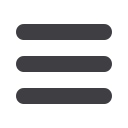Alchimie
61
la pourpre. On y trouve l’idée d’une unité fondamentale de la matière et celle
des rapports de sympathie entre les substances, exprimée par la célèbre formule
fréquente dans tout le corpus
: « La nature est charmée par la nature, la nature
vainc la nature, la nature domine la nature. » À ce stade, on rapporte aussi une
série de citations ou courts traités des « vieux auteurs » mythiques tels qu’Her-
mès, Agathodémon, Isis, Cléopâtre, Marie la Juive (entre le i
er
et le iii
e
siècle).
La deuxième période est celle des auteurs proprement dits : Zosime de Panopolis,
Pélagios, Jamblique (iii
e
-iv
e
siècle apr. J.‑C.). Zosime apparaît comme la plus
grande figure de l’alchimie gréco-égyptienne. Parmi ses morceaux les
plus célèbres, il faut mentionner les trois
Visions
décrivant des rêves qui auraient
dévoilé à Zosime les propriétés des métaux. Jung s’est beaucoup intéressé aux
Visions
qu’il considérait comme des images archétypales reflétant un processus
d’identification entre l’opérateur et les matières. En dehors de la tradition
grecque, des œuvres sous le nom de Zosime ont été conservées en syriaque, en
arabe et en latin. Dans les fragments syriaques (ms. syriaque, Cambridge, 6.29),
on trouve les seules recettes antiques pour la fabrication du célèbre et mysté-
rieux « bronze noir » de Corinthe, très prisé par les Romains et mentionné par
Pline l’Ancien. La troisième période est celle des « commentateurs » : Synésius
(iv
e
siècle), Olympiodore (vi
e
siècle), Stéphanus (vii
e
siècle) et deux anonymes,
appelés respectivement le Philosophe chrétien et l’Anépigraphe (entre le vi
e
et
le viii
e
siècle). Selon la tradition arabo-latine, c’est justement un élève de
Stéphanus, le moine Morienus (Marianos), qui diffusera l’alchimie dans le
monde arabe en initiant entre 675 et 700 le prince omeyyade Khâlid ibn Yazîd
(mort en 704). Ces auteurs visent essentiellement à clarifier la pensée de leurs
prédécesseurs et représentent le stade le plus avancé de la théorisation de l’al-
chimie grecque. On assiste chez eux à un véritable processus de définition et
de systématisation de la doctrine alchimique à travers les outils de la philosophie
grecque. La tradition alchimique à Byzance se termine avec Michel Psellos
(xi
e
siècle), Nicéphore Blemmydès (xiii
e
siècle) et Cosmas (xv
e
siècle).
Ingrédients et opérations
Les substances mentionnées dans les textes des alchimistes grecs sont souvent
exprimées par un langage codé difficile à décrypter. Outre les sept métaux déjà
identifiés par les Anciens (or, argent, cuivre, mercure, fer, étain et plomb), les
alchimistes utilisaient des minerais natifs, comme le
natron
(ingrédient typi-
quement égyptien provenant du Ouadi Natroum, employé notamment pour
la momification), le soufre, le marbre, le sel ainsi que des substances d’origine
végétale et organique. Quant à la production des métaux nobles, les opérations