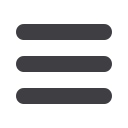Alchimie
66
le domaine de l’alchimie arabe, presque vierge de toute investigation, ne permet
pas d’établir des vérités, mais seulement des conjectures. La plupart des textes
restent en effet inédits, voire inconnus, et les chronologies se fondent le plus
souvent sur les quelques rares ouvrages édités, quand ils sont datables. Parmi les
premières œuvres, on trouve quelques traductions, souvent parcellaires (voire de
simples citations), d’auteurs réels (Zosime) ou de pseudépigraphes (Démocrite,
Ostanès, Empédocle, etc.), dont certains sont conservés en grec. Toutefois, bon
nombre des premiers traités alchimiques arabes sont des textes présentés comme
des traductions, mais semblent en réalité avoir été composés directement en
arabe. Une abondante littérature alchimique pseudépigraphique voit ainsi le
jour, et de grandes figures grecques telles que Socrate ou Platon se voient attri-
buer des traités alchimiques.
L’alchimie arabe
Les doctrines alchimiques grecques, à l’instar des autres champs du savoir, ont
été assimilées assez rapidement par les auteurs arabes. Les compositions origi-
nales apparaissent fort tôt. Toutefois, cette étape d’assimilation a tantôt appro-
fondi, tantôt modifié certains points de ces doctrines. Un exemple frappant se
trouve dans la théorie du soufre et du mercure, que l’on peut déjà lire dans le
Kitâb sirr al-khalîqa
(Livre du secret de la création)
, faussement attribué à Balînûs
(Apollonios de Tyane), dont l’état actuel suggère une composition au ix
e
siècle,
mais dont certaines parties pourraient être antérieures. Dans ce texte, dont l’in-
fluence a été considérable dans le monde arabe, Balînûs explique que les métaux
ont été créés à partir de soufre et de mercure cuits dans les entrailles de la terre
durant des centaines d’années. Si certains éléments nécessaires à cette doctrine
s’observent déjà dans les œuvres alchimiques grecs, et surtout dans la théorie
de la double exhalaison d’Aristote (
Météorologiques
, III, 7 [378a-b]), elle n’y est
jamais affirmée littéralement. Il est difficile de définir avec précision l’autre fond
théorique qui a ici influencé l’auteur (persan, chrétien, ou autre), car aucun
texte n’a survécu.
Plusieurs ouvrages attribués à des auteurs arabes fort anciens, comme le calife
omeyyade Khâlid ibn Yazîd (mort en 704), qui aurait été selon la légende le dis-
ciple d’un moine byzantin alchimiste nommé Maryânûs, sont fort probablement
postérieurs et apocryphes. Cependant, l’absence d’édition et d’étude approfon-
die de ces textes ne permet à nouveau que la conjecture.
Une des figures majeures de l’alchimie arabe est le personnage de Jâbir ibn
Hayyân. Ce savant, qui aurait vécu à la fin du viii
e
siècle et aurait été le dis-
ciple de l’imam chiite Ja‘far al-Sâdiq, est l’auteur allégué d’un nombre impor-
tant de textes alchimiques. Les divergences de style et de contenu dans ces traités
ne laissent cependant que peu de doutes sur leur caractère pseudépigraphique ;