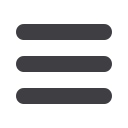Alchimie
69
techniques (instruments comme l’alambic et l’aludel, deux mots arabes, ou des
substances, etc.).
La réception de l’alchimie est un mouvement complexe encore mal connu.
Les savants de l’Occident ont considéré que l’alchimie pouvait offrir une contri-
bution majeure au savoir minéralogique. Cependant, l’alchimie n’a jamais véri-
tablement pénétré le monde universitaire occidental médiéval. L’une des raisons
en est la traduction par Alfred de Sareshel dans les années 1160 d’une partie du
cinquième
fann
des
Tabî‘iyyât
(Physique)
du
Kitâb al-Shifâ’
(Livre de la guéri-
son)
d’Avicenne, le
Kitâb al-ma‘âdin wa-al-âthâr al-‘ulwiyya
(Livre des minéraux
et des phénomènes supérieurs)
, dans lequel le philosophe se positionne contre la
possibilité de la transmutation des espèces. Le traducteur a placé ce petit passage
à la fin des
Météorologiques
d’Aristote, ce qui a conféré au texte une autorité de
poids. Cette assertion a lancé un fougueux débat concernant la possibilité de la
transmutation aux xiii
e
et xiv
e
siècles.
L’assimilation de l’alchimie arabe : le
xiii
e
siècle
Tout comme dans le monde arabe, les débuts de l’alchimie voient apparaître,
aux côtés des traductions, des textes rédigés dans le style des traductions, teintés
d’arabismes, dont il est parfois difficile de déterminer l’origine. Ainsi, le
De per-
fecto magisterio
du Pseudo-Aristote ressemble à une traduction, mais pourrait
également avoir été composé directement en latin.
À partir du début du xiii
e
siècle, l’assimilation de l’alchimie arabe par le monde
latin se confirme et des ouvrages écrits en latin par des Latins voient le jour. Ainsi,
le fameux traducteur Michel Scott (mort en 1235) a peut-être composé une
Ars
alchemiae
(Art d’alchimie)
, traité d’alchimie intégralement fondé sur des éléments
arabes, qui contient très peu d’informations théoriques pour un grand nombre
de recettes. L’œuvre se présente comme une tentative d’éclaircissement des textes
arabes parfois contradictoires, et participe pleinement de la phase d’assimilation.
Du côté du monde universitaire, Albert le Grand (1193‑1280) rédige un
De mineralibus
dans lequel il entreprend de faire une première synthèse des
connaissances minéralogique du temps, fondée sur des sources arabes et latines.
Il se prononce pour la possibilité théorique de la transmutation, mais affirme
n’avoir jamais vu une réalisation pratique de la chose. De nombreux traités alchi-
miques, probablement inauthentiques, lui sont attribués.
Plus militant, Roger Bacon (1214‑1293), dans plusieurs de ses œuvres, consi-
dère l’alchimie comme un domaine essentiel du savoir. Il en fait le fondement
de la médecine, et élabore, le premier en Occident, une théorie de
prolongatio
vitae
(prolongation de la vie) qui permettrait de soigner et d’augmenter considé-
rablement la longévité des hommes. Parmi les œuvres alchimiques qui lui sont
attribuées, il est difficile de faire la part des choses concernant l’authenticité.