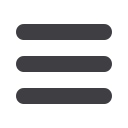Alchimie
70
À la fin du xiii
e
siècle, à côté des traductions d’œuvres arabes attribuées à Jâbir
ibn Hayyân (Geber en latin), un corpus de textes attribués à Geber se compose
en latin, dont le principal représentant est la
Summa perfectionis
. Ce traité alchi-
mique est rapidement devenu une des sources majeures de toute l’alchimie des
siècles suivants. La doctrine qu’il présente se place en porte-à-faux avec celle qui
dominait le paysage jusque-là : différentes matières étaient défendues pour la
confection de l’élixir, mais on donnait généralement la préséance aux substances
organiques, théorie dont le
De anima
alchimique du Pseudo-Avicenne était le
premier tenant ; avec la
Summa perfectionis
, l’élixir n’est composé qu’à partir de
substances minérales mercurielles.
Dans ce xiii
e
siècle d’essor technologique et économique, l’alchimie trouve
une place, et plusieurs savants s’y intéressent, comme Vincent de Beauvais,
Robert Kilwardby et Thomas d’Aquin. Ils ne la classifient cependant jamais
parmi les arts libéraux, mais toujours parmi les arts mécaniques (tout comme
la médecine), comme une branche secondaire de la philosophie de la nature,
une simple application pratique de cette théorie philosophique. L’augmentation
de fraudes alchimiques commence toutefois à susciter des méfiances à l’égard de
l’alchimie.
L’alchimie proprement latine : les
xiv
e
et
xv
e
siècles
Aux xiv
e
et xv
e
siècles, les sources des auteurs alchimiques sont non plus seu-
lement les traductions de l’arabe, mais aussi et surtout les textes composés en
latin au xiii
e
siècle. Parmi ceux-ci, c’est avant tout la
Summa perfectionis
et sa
théorie du « mercure seul » qui va l’emporter. Le côté allégorique de l’alchi-
mie, déjà présent dans la
Tabula chemica
d’Ibn Umayl et la
Turba philosopho-
rum
, se développe. On observe également une christianisation de l’alchimie.
La prolongation de la vie et la médecine par l’alchimie deviennent un thème
central pour les auteurs.
Le médecin catalan Arnaud de Villeneuve (1240‑1311) se voit attribuer un
corpus important d’œuvres alchimiques, dont l’authenticité, probablement fausse,
reste sujette à discussion. Le
Rosarius philosophorum
en est le principal représen-
tant. D’autres traités, comme le
De secretis naturae
et le
Tractatus parabolicus
,
décrivent des liens entre la pierre des philosophes et le Christ.
Un autre corpus de textes alchimiques est attribué au philosophe catalan
Ramón Llull (vers 1233-vers 1316), qui est pseudépigraphique : le philosophe
était en effet opposé à l’alchimie. Ce corpus jouira d’une diffusion très importante
(jusqu’au xvii
e
siècle). La pièce majeure de cette collection est le
Testamentum
,
qui présente des points communs avec la doctrine de plusieurs ouvrages attri-
bués à Arnaud de Villeneuve (sans qu’on puisse définir le sens ni la chronologie
de cette transmission).