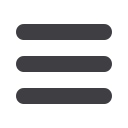Alchimie
63
L’ésotérisme de l’alchimie
Dans l’alchimie grecque, on retrouve les deux aspects fondamentaux de l’« éso-
térisme » qui découlent de l’étymologie même du mot
esoterikos
(interne) : la
spécialisation technique et l’intériorisation mystique. En premier lieu, comme
tout savoir spécialisé, technique ou philosophique, l’alchimie demande un
apprentissage, une initiation à des « doctrines internes », dans le sens aristotéli-
cien d’« internes à une école ». Les alchimistes sont des « initiés »
(mustai)
et ont
accès à des mystères
(mustêria)
issus d’une révélation faite originairement par un
être surnaturel. Par exemple, dans la
Lettre d’Isis à Horus
, le secret de la prépara-
tion de l’or et de l’argent est le fruit d’une révélation d’un ange à Isis qui, à son
tour, la transmet à Horus, son fils unique et légitime. Zosime reçoit en songe
des révélations sur les propriétés des métaux. L’usage d’occulter délibérément la
vérité est un trait constant de la littérature alchimique, admis par les alchimistes
eux-mêmes. D’où l’éloge du silence, l’obscurité des expressions, les allégories, les
métaphores, le langage symbolique. Dans le
Compte final
(
caag,
II, 239, 12 s.),
Zosime raconte que les artisans des rois d’Égypte, préposés à accroître les trésors
royaux, étaient censés garder le secret afin de ne pas permettre aux autres l’accès
au pouvoir dominateur de la richesse. Ce qui rappelle la raison de la destruc-
tion des livres alchimiques ordonnée par Dioclétien et rapportée par les chroni-
queurs byzantins. De même, dit Zosime, Démocrite et les Anciens, qui étaient
amis des rois d’Égypte, ont caché cet art dans l’intérêt des rois, mais aussi par
une forme de jalousie, dirions-nous, scientifique. Le binôme jalousie/secret est
fréquent dans le corpus des alchimistes grecs. On retrouve souvent l’opposition
entre les « jaloux », qui ont caché la vérité sous une multiplicité de mots, et les
philosophes « sans jalousie », qui se sont exprimés de manière claire. Chez les
commentateurs, dont le but principal est de clarifier les écrits des Anciens, l’obs-
curité de ces derniers est souvent considérée comme apparente. Olympiodore,
par exemple, au sujet de l’« eau divine », montre que le langage allégorique et
philosophique des Anciens est en réalité clair et sans jalousie. Il fait remonter
l’usage des expressions énigmatiques à Platon et Aristote, et il explique que le but
est d’inciter les chercheurs à poursuivre leur enquête au-delà des phénomènes
physiques (
caag,
II, 70, 4 s.).
L’autre versant de l’ésotérisme alchimique est celui d’un chemin à l’« inté-
rieur », non plus seulement d’une discipline, mais de soi. Chez Zosime, on trouve
le dogme hermétique, ou plus généralement gnostique, de la connaissance de
Dieu et de l’accueil de Dieu en soi-même. La séparation de l’âme du corps (voir
les fréquentes allusions à l’homme « intérieur » ou « pneumatique ») apparaît
comme le but idéal d’une transformation intérieure de l’homme qui semble se