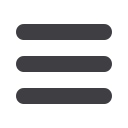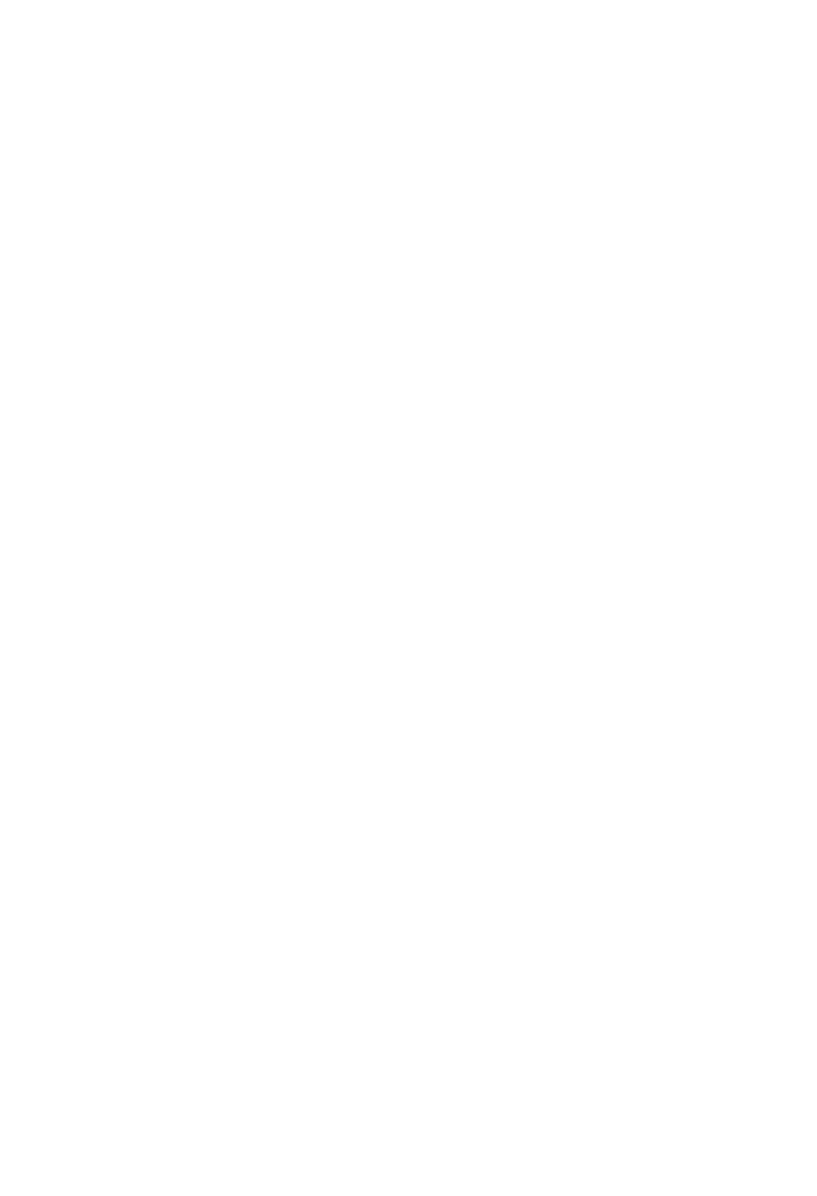
Alchimie
67
si le noyau originel remonte peut-être à un seul auteur, le reste semble le tra-
vail d’une école d’alchimistes du ix
e
siècle. L’alchimie développée dans le cor-
pus jâbirien tire son origine de doctrines médicales et philosophiques grecques,
et constitue la théorie des élixirs : toutes les choses sont composées des quatre
éléments et diffèrent selon leur proportion élémentaire, or il est possible, selon
ces alchimistes, d’isoler les éléments par la distillation fractionnée de certaines
substances ; on peut donc créer un savant mélange d’éléments isolés et prépa-
rés pour ensuite le projeter sur un métal, et ainsi le transformer en changeant sa
proportion élémentaire. L’alchimie jâbirienne présente en outre certains côtés
mystiques et théologiques intimement liés aux considérations philosophiques et
techniques, et semblent indiquer une tendance chiite des auteurs.
Une autre figure marquante, plus que probablement historique et authentique,
quant à elle, est l’alchimiste persan Abû Bakr al-Râzî (mort en 925 ou 935). Ses
œuvres révèlent une alchimie plus expérimentale et technique, et se distinguent
par des descriptions fort détaillées et pertinentes, qui exerceront une influence
importante. Il est cependant parfois difficile de déterminer précisément ce qui
relève proprement de cet auteur, car on le sait influencé par les traités jâbiriens,
et certaines de ses constatations expérimentales se retrouvent dans ces textes.
Parmi les nombreux alchimistes arabes, on peut encore mentionner Ibn
Umayl, auteur égyptien de la première moitié du x
e
siècle, qui présente une
alchimie allégorique et mystique, dans laquelle il décrit le grand œuvre sous le
couvert de divers symboles.
L’alchimie occupe une place contrastée dans les différentes classifications
des sciences en Islam. Si certains grands auteurs ne la considèrent pas comme
une science fondamentale, comme al-Fârâbî (mort en 950) ou Ibn Sînâ (Avicenne,
mort en 1037), elle est tenue pour une branche importante du savoir chez plu-
sieurs savants, comme dans les
Mafâtîh al-‘ulûm
(Clefs des sciences)
de Khuwârizmî
(fin x
e
siècle), chez les
Ikhwân al-Safâ’
(Frères de la pureté, fin ix
e
-début x
e
siècle),
ou encore dans le
Fihrist
(Catalogue)
du libraire Ibn al-Nadîm (mort en 995).
L’alchimie latine
Les traductions latines de l’arabe : les
xii
e
et
xiii
e
siècles
À partir de la fin du xi
e
siècle, un large mouvement de traductions de l’arabe vers
le latin s’amorce en Italie et en Espagne, et vient féconder l’Occident latin en
lui offrant de nouveaux matériaux non seulement antiques (traductions en latin
de traductions arabes d’ouvrages grecs), mais aussi et surtout médiévaux arabes.
Parmi les disciplines qui ont intéressé les traducteurs, l’alchimie prend une place