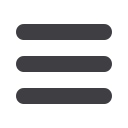Alchimie
59
plus fréquemment admise pour l’étymologie du mot arabe est une transcrip-
tion du grec
chumeía
/
chêmeía
(fusion, alliage), par l’intermédiaire du syriaque
kîmîyâ
. Le périple de l’alchimie est avant tout méditerranéen : l’alchimie latine
est entièrement fondée sur les textes arabes, qui ont eux-mêmes hérité avant tout
de l’alchimie grecque hellénistique, transmise aux alentours des viii
e
-ix
e
siècles,
le plus souvent via des intermédiaires syriaques.
Deux idées reçues doivent être rectifiées. Les alchimistes ne sont générale-
ment pas des fanfarons ou des farfelus, mais bien souvent des personnages à la
pointe de la science de l’époque : une majorité des recettes alchimiques sont véri-
diques et peuvent être reconstituées, et la production de l’or et de l’argent est loin
d’être le seul objet des traités. Il faut également mentionner que les alchimistes
ne séparent que très rarement théorie et pratique : cette conception est plutôt
moderne, et les auteurs antiques et médiévaux ne se représentent jamais les tech-
niques en dehors des cadres conceptuels dont ils ont hérité ou qu’ils ont élaborés.
Antiquité
Les alchimistes gréco-alexandrins faisaient remonter l’origine de leur art à l’Égypte
ancienne, thèse que la plupart des historiens ont suivie. On a aussi supposé
des relations avec l’alchimie mésopotamienne, indienne et chinoise mais, au-delà de certaines parentés de thèmes ou de procédés, on n’a, à présent, aucune
preuve décisive d’une influence réciproque. En effet, l’alchimie grecque est un
phénomène particulier, éminemment alexandrin et « méditerranéen », à la fois
complexe et unique en son genre, né à la confluence de traditions techniques,
intellectuelles et religieuses propres à l’Égypte gréco-romaine. Les alchimistes
se définissent eux-mêmes comme des « philosophes », Platon et Aristote appa-
raissent en tête des listes des anciens maîtres de l’art, certains d’entre eux sont
appelés « exégètes de Platon et d’Aristote ».
L’intérêt des Modernes pour l’alchimie grecque fut suscité par les travaux du
chimiste Marcelin Berthelot,
Les Origines de l’alchimie
(1885) et la
Collection
des anciens alchimistes grecs
(1888‑1889) [
caag
], qu’il publia en collaboration
avec l’helléniste Charles-Émile Ruelle. L’approche historique de Berthelot était
essentiellement rationaliste. Il voyait dans l’alchimie l’origine de la méthode expé-
rimentale et la préparation de la chimie moderne. La
Collection
fut considérée
comme plutôt faible du point de vue de la rigueur philologique, mais elle eut le
grand mérite de diffuser ces textes et de stimuler la recherche érudite. Entre 1924
et 1932 furent publiés les huit volumes du
Catalogue des manuscrits alchimiques