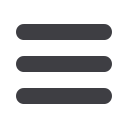Identification
672
La mobilité des personnes
Dans les sociétés de « face à face » que furent les sociétés précontemporaines,
un individu pouvait recourir au témoignage oral pour prouver qui il était. Mais
comment prouvait-il son « identité », c’est-à-dire ses appartenances pertinentes,
lorsqu’il se déplaçait loin de son domicile ? Et ce n’était pas nécessairement son
identité ethnique ou civique qu’il pouvait avoir à attester, mais parfois son appar-
tenance religieuse ou encore son statut social : car le migrant n’est pas seulement
l’étranger ; ce peut être, à l’intérieur d’un même espace politique, celui qui vient
de la cité ou de la ville voisine.
L’intense circulation des personnes et des biens, des savoir-faire et des pratiques
a constitué dans la très longue durée, de l’Antiquité à l’époque moderne, un élé-
ment structurant et structuré de l’espace méditerranéen conçu comme un sys-
tème réticulaire. Liberté de circulation et contrôle des flux et passages y sont
étroitement liés et en fait interdépendants. Dans les sociétés précontempo-
raines, ce n’est toutefois pas, le plus souvent, le flux qui inquiète, ni l’étranger
qui dérange, ni le territoire qu’on cherche à protéger, mais certaines catégories
de population qu’il s’agit d’encadrer ou même de surveiller, pour contrôler les
échanges, pour protéger ceux qui détiennent un privilège, ou simplement pour
maintenir l’ordre public.
Dans l’identification des personnes en déplacement, les autorités publiques,
centrales ou locales,
ne jouaient pas toujours le rôle le plus important. Sous
l’Empire romain, par exemple, elles laissaient en partie le soin du contrôle de
la mobilité aux « institutions médiatrices », collèges, corporations, communau-
tés, et aux réseaux d’amitié, de clientèle et d’hospitalité. Les accords d’hospitalité
donnaient lieu à l’échange d’objets, les tessères d’hospitalité, ou étaient consignés
dans des tablettes, qui servaient de moyen de reconnaissance entre deux familles.
Des documents de voyage, mais aussi des lettres de recommandation, l’un des
modes d’identification les plus répandus en Méditerranée dès les plus hautes
époques, facilitaient également les déplacements : ils permettaient au voyageur
(un particulier ou un membre d’une corporation) d’être hébergé et de recevoir
éventuellement une assistance judiciaire ou même médicale, une pratique qu’on
retrouve dans les communautés chrétiennes antiques.
Des lettres de recommandation ont de même facilité les déplacements des
voyageurs non seulement du « Grand Tour » de l’époque moderne mais aussi de
toutes sortes de catégories de populations mobiles : les étudiants, les marchands-voyageurs dont la correspondance parfois soutenue assurait la pérennité des
affaires à distance, ou encore les artistes et artisans dont la circulation est, depuis
l’Antiquité, assurée par ces réseaux sociaux. À l’époque moderne, les corps de