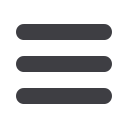Identification
678
le souci de contrôler les personnes migrantes et le développement des procé-
dures modernes d’identification. Certes l’intensité des circulations change de
nature et le xix
e
siècle correspond bien à un basculement, sur le plan numé-
rique, des flux de circulation qui transitent dans et par l’espace méditerranéen.
Mais le changement de statut de l’identité personnelle répond aussi à toutes
les autres transformations des sociétés contemporaines, qui, en se superposant,
dessinèrent une cartographie renouvelée des fonctions et des statuts assumés
par les individus. La définition des identités suivant les périodes – les « régimes
d’identité » – étant étroitement reliée aux structures profondes des systèmes
sociaux et au fonctionnement même des sociétés, il serait vain d’isoler, pour la
période contemporaine, un facteur plus qu’un autre pour expliquer les trans-
formations à l’œuvre. La construction progressive des État-nations suscite de
nouvelles contraintes en matière d’identification, les individus étant sommés
de choisir et de démontrer leur appartenance à une nationalité pour répondre
aux contrôles ou pour bénéficier de certains droits réservés aux nationaux. Les
logiques économiques et administratives, qui président à la gestion de la main-d’œuvre employée de plus en plus massivement dans l’industrie, exigent égale-
ment une détermination précise des identités pour favoriser l’orientation et la
fluidité des circulations. Sur un autre plan, la dématérialisation des transactions
financières et la judiciarisation accélérée des rapports contractuels produisent
aussi des moyens adaptés pour certifier l’identité des parties et protéger leur
confidentialité. Dans le contexte impérial, des pratiques spécifiques tendent
à discerner et isoler certaines catégories de population et contribuent à l’ordon-
nancement hiérarchisé des sociétés coloniales. Le cadre des États nationaux se
conjugue donc à divers processus qui produisent à la fois des procédures origi-
nales de certification et de nouvelles manières de dire l’identité.
Fixer l’identité civile
Dans les pays de cultures chrétiennes, les registres paroissiaux demeurent long-
temps la base unique de référence qui enregistre l’identité des individus. Le prin-
cipe d’un état civil laïque, introduit en 1792 sous la Révolution française, transfère
théoriquement du clergé aux municipalités la tenue de ces registres, marquant en
cela la fin du monopole séculaire de l’Église. La fondation de services effectifs de
l’état civil intervient plus tardivement et accompagne les périodes d’unification, en
Italie (1865), en Espagne (1870) ou de refondation comme au Portugal (1911),
après la proclamation de la République. Elle concerne aussi les territoires d’em-
pire comme l’Algérie coloniale où l’état civil, créé officiellement en 1830, n’est
appliqué qu’à partir de 1882 à l’ensemble des « indigènes musulmans » soumis,