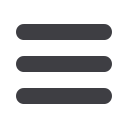Identification
682
des flux migratoires. Avec la crise économique des années 1970, la figure du
« sans-papiers » s’est imposée à la fois comme l’image récurrente d’une immigra-
tion réputée incontrôlable et comme l’expression d’une renonciation aux valeurs
humanistes : la construction d’une Europe en forteresse et l’internationalisation
des fichiers biométriques conduisent à une vaste entreprise de fichage destinée
à limiter l’afflux des migrants venus d’Afrique et d’Asie vers l’Europe ; des « centres
de rétention » ou « d’identification » et une expulsion planifiée des clandestins
s’inscrivent dans le paysage des flux migratoires Sud-Nord et semblent parfois
résumer l’état des relations entre les deux rives de la Méditerranée. Une identi-
fication absolue, qui résulte du processus historique de légitimation du principe
de l’identification, s’est imposée désormais comme une nécessité pour la majeure
partie des sociétés contemporaines.
Le fait de ne porter sur soi aucun des documents d’identité prévus par la loi
ou par les règlements des administrations, quelles qu’elles soient, constitue très
rarement un délit. Pourtant, les portefeuilles se sont épaissis avec constance depuis
plusieurs décennies : permis de conduire, carte de transport, carte de visite, carte
professionnelle, carte de club, carnet de famille ou de santé, cartes de fidélité en
tout genre et papiers officiels accompagnent chaque déplacement et balisent un
très grand nombre de face à face avec les agents des administrations et, depuis
les années 1990, avec des lecteurs automatiques informatisés. Le recours récent
à l’électronique renforce le caractère indolore des opérations de contrôle, et la
vérification instantanée des bases de données semble assurer la protection des
données et la rapidité des opérations. L’acculturation diffuse des populations
aux procédures d’identification traduit le consentement collectif qui rend pos-
sible un contrôle incessant et permanent des identités.
Le droit à l’anonymat et la défiance assumée face aux technologies de contrôle
apparaissent dans les écrits révolutionnaires, dès les années 1900, et dans la cri-
tique de la modernité formulée souvent par des réfugiés et des exilés dans l’entre-deux-guerres. Les questionnements posés par les sciences sociales, à partir des
années 1970, et l’étude du caractère « construit » des identités ont ensuite pour-
suivi cette réflexion. L’individu contemporain est dès lors défini comme situé à la
lisière de multiples identités prédéfinies. Tout en circulant de l’une à l’autre dans
sa vie quotidienne, des revendications identitaires ou statutaires exigent occasion-
nellement une immobilisation ou un positionnement partisan destiné à mettre
en avant l’une ou l’autre partie de son identité multiple. Afin d’échapper à cette
assignation, des stratégies d’évitement, par la fraude ou le contournement, ou
de résistance peuvent intervenir. Mais le rôle puissant des appartenances asso-
ciées aux nécessités économiques et aux impératifs juridiques ou réglementaires
décide en dernier lieu de ces identifications. Pour échapper à ces assignations
identitaires constantes, et qui peuvent s’avérer intolérables, des voies de sorties