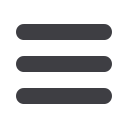Identification
679
dès lors, à l’obligation du patronyme. Dans certains cas, l’administration d’un
état civil articulé accompagne l’organisation régulière des recensements qui tra-
duisent l’engagement des autorités centrales dans la conquête administrative des
territoires. Dans l’Empire ottoman, les officiers d’état civil se joignent, autour
de 1840, aux inspecteurs du ministère de la Population chargés d’enregistrer les
populations de l’Empire. Cet enregistrement par province se poursuit jusqu’à la
promulgation, en 1890, d’une loi sur l’état civil. Dans l’Égypte, sous domina-
tion ottomane ou sous protectorat britannique, il n’existe aucun état civil avant
les années 1950, et l’enregistrement des individus reste entièrement du ressort
des communautés qui se chargent elles-mêmes de moderniser et rationaliser les
rubriques des registres.
À l’échelle de la Méditerranée, la stabilisation des identités, sous la forme
qu’elle prend actuellement – un prénom, un nom, une date et un lieu de nais-
sance, de mariage, de décès, etc. –, se diffuse très progressivement et très iné-
galement. Elle dépend à la fois des développements de l’état civil et, pour les
hommes, de la conscription militaire à laquelle il devient presque impossible
d’échapper à partir de la fin du xix
e
siècle. Les guerres et calamités naturelles
entraînent cependant la destruction des archives qui laissent une part non négli-
geable de la population sans moyen de prouver son état civil. La création tar-
dive, en 1948‑1949, d’une Commission internationale de l’état civil, qui siège
à Strasbourg, et son maintien jusqu’à aujourd’hui traduisent les difficultés nom-
breuses rencontrées en vue de parvenir à une véritable unification des pratiques
à l’échelle internationale.
Les réformes de l’identité judiciaire
Les impératifs en matière de paix sociale, de pacification des territoires et d’ordre
public conduisent à cibler certaines catégories de population qui font l’objet
d’un enregistrement et d’une identification spécifique : catégories subalternes
des sociétés coloniales, insurgés, révolutionnaires ou anarchistes, groupes répu-
tés criminogènes comme les prostitués, vagabonds ou « Tsiganes », criminels
condamnés, bagnards et récidivistes. Tous ces groupes dont la littérature crimi-
nologique du xix
e
siècle caractérise les membres par des déterminants supposé-
ment stables, voire héréditaires, mobilisent l’attention des autorités et incitent
les institutions judiciaires à repérer et identifier les individus avec précision. La
possibilité d’échapper au régime de la peine et l’idée que des individus puissent
se confondre aux couches élevées de la société deviennent progressivement insup-
portables et l’anonymat, la dissimulation ou, pire, l’usurpation sont érigés en
fléaux, notamment dans la presse de masse alors en plein essor.