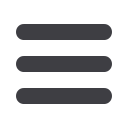Échanges commerciaux
416
voyageaient normalement par voie d’eau : les marchés de l’intérieur, qui peuvent
n’être distants que de quelques kilomètres de la côte ou du point de rupture de
charge d’un fleuve navigable, ont une vie et une évolution différentes de celles
des sites littoraux. L’Empire romain ne constituait donc pas un modèle de mar-
ché généralisé mais une juxtaposition de conditions locales créées par la demande
et les possibilités de distribution. Les cas de Rome et de l’armée, dont les besoins
massifs ont si fortement marqué notre vision des échanges, ne peuvent rendre
compte de la nature globale des commerces méditerranéens.
Au tournant de notre ère, en effet, les nécessités du ravitaillement de Rome,
une mégapole de plus d’un million d’habitants, sont cruciales et le commerce
maritime se développe sur une échelle qui ne sera pas dépassée avant l’ère pré-
industrielle : André Tchernia, qui a calculé le nombre de navires et les inves-
tissements nécessaires au ravitaillement de Rome, a conclu que toute la flotte
française du xviii
e
siècle n’y aurait pas suffi. Le transport du blé est contrôlé :
depuis le milieu du iii
e
siècle av. J.‑C., la Sicile fournit d’importantes quanti-
tés de blé, qui seront ensuite assurées par l’Égypte et l’
Africa
. Le rôle de l’État
dans l’approvisionnement des greniers publics de Rome
(annone)
, la nature des
produits impliqués, le nombre des récipiendaires ont fait l’objet de nombreuses
études : si les propositions divergent parfois sur les chiffres, on s’accorde toute-
fois à considérer la complexité du système. L’empereur a en charge le ravitail-
lement mensuel du blé destiné aux bénéficiaires des distributions gratuites (au
moins 150 000 ayants droit), auxquels s’ajoutent les habitants de Rome qu’il
faut nourrir sous peine d’émeutes, soit des valeurs moyennes de 60 millions de
modii
(420 000 t) de blé par an à l’apogée de l’Empire. Pour donner un ordre
de grandeur des arrivées des seules denrées que l’archéologie permet d’évaluer,
et qui sont des quantités par défaut, on peut ajouter 150 000 hl d’huile et entre
1 et 3 millions d’hectolitres de vin. Mais l’intérêt des empereurs ne se limita
pas aux produits alimentaires : ainsi Sévère Alexandre, au début du iii
e
siècle,
se préoccupe-t‑il d’assurer aux bains publics une fourniture suffisante en bois
à brûler en leur destinant des forêts spécifiques (
SHA
,
Alex. Sev.
24,5).
L’armée est le second grand domaine d’intervention de l’État. La présence
romaine sur les frontières
(limes)
de Germanie dès l’époque d’Auguste, du
Danube à partir du début du ii
e
siècle, implique la nécessité de ravitailler des
populations d’autant plus nombreuses qu’aux légions s’ajoutent les auxiliaires,
les familles, les esclaves, marchands et artisans, formant des concentrations de
population considérables : on peut ainsi estimer que les huit légions présentes
en Germanie sous Tibère constituent un groupement de près de 160 000 per-
sonnes. En règle générale, les camps forment des agglomérations comparables
aux plus grandes villes de l’Empire, Rome exceptée, qu’il faut ravitailler en biens
de consommation méditerranéens.