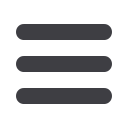Échanges commerciaux
412
Échanges commerciaux
Antiquité
« Qui êtes-vous ? D’où venez-vous, par les routes humides ? Êtes-vous des mar-
chands, ou errez-vous à l’aventure, tels les pirates sur les eaux qui vont rôdant,
risquant leur vie en attaquant les nations d’autre langue ? » Telle est la ques-
tion posée à Télémaque cherchant son père (Homère,
Odyssée
, III, 72‑75) puis
à Ulysse (
ibid
., IX, 252‑255) lorsqu’ils abordent de nouveaux rivages. Car entre
le viii
e
et le vi
e
siècle av. J.‑C., pour les Grecs, qui vont naviguer dans le sillage des
Phéniciens à la recherche de métaux, les échanges commerciaux en Méditerranée
s’apparentent plutôt à des épopées, menées par des aventuriers, aristocrates en
mal de conquête et de gloire ou déshérités cherchant à survivre ailleurs que sur
la terre de leurs aïeux, morcelée et devenue insuffisante pour les nourrir. La
Méditerranée s’ouvre aux échanges maritimes à partir du ix
e
siècle avec l’expan-
sion phénicienne et grecque de l’Orient vers l’Occident, même si les Minoens
puis les Mycéniens au II
e
millénaire ont amorcé le mouvement. Elle devient
rapidement un espace d’échanges, où les progrès de la navigation favorisent les
relations entre les différents peuples vivant sur son pourtour, Phéniciens, Grecs,
Étrusques et autres. Certes, l’historiographie a longtemps minimisé l’ampleur de
ces déplacements, car elle était partagée entre partisans de la thèse dite « primi-
tiviste », longtemps clé de lecture de l’économie grecque, et « modernistes ». Les
premiers diffusaient la vision d’une société antique impliquée essentiellement
dans une économie agraire de subsistance et peu soucieuse d’édicter des règles
commerciales ou de mener une réflexion politique sur le sujet (Moses I. Finley),
les seconds étaient partisans d’une économie largement dominée par les échanges
commerciaux (théorie reprise et développée récemment par Alain Bresson). Sur
ce débat ancien est venu s’en greffer un autre qui conditionne encore notre vision
des échanges en Méditerranée : la thèse d’un Braudel, faisant de la Méditerranée
un espace spécifique, constitué d’espaces autonomes qui « ont tendance à vivre