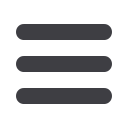Échanges commerciaux
420
Marin, Brigitte et Virlouvet, Catherine (dir.),
Nourrir les cités de Méditerranée. Antiquité-Temps modernes
, Maisonneuve et Larose –
mmsh
, Paris, 2003.
Pomey, Patrice,
La Navigation dans l’Antiquité
, Édisud, Aix-en-Provence, 1997.
Tchernia, André,
Les Romains et le commerce
, Centre Jean Bérard – Centre Camille
Jullian, Naples, 2011.
Temin, Peter, « A Market Economy in the Early Roman Empire »,
Journal of Roman
Studies
, 91, 2001, p. 169‑181.
Moyen Âge
En dépit de mutations politiques et économiques majeures, les échanges en
Méditerranée n’ont jamais été interrompus. Les hommes et les marchandises
n’ont pas cessé de parcourir ses rivages et de la traverser, en multipliant les
contacts et les transactions de toutes sortes. Dans son ouvrage intitulé
Mahomet
et Charlemagne
, Henri Pirenne émet l’hypothèse d’une rupture entre Orient et
Occident à partir du vii
e
siècle ; selon lui, les échanges auraient considérablement
diminué, l’or aurait disparu et les villes auraient décliné. À la lumière de nou-
veaux témoignages, notamment des recherches archéologiques, cette hypothèse
est remise en cause. Il apparaît au contraire que l’or byzantin a continué à circu-
ler ; les musulmans l’ont utilisé pour acquérir en Occident des matières premières
telles que les fourrures, le bois ou les esclaves. L’empire carolingien a entretenu
avec le califat abbasside de Bagdad et le monde musulman, de façon générale,
des relations commerciales et des rapports diplomatiques, traduits par l’échange
d’ambassades. Les conquêtes musulmanes ont créé un immense domaine éco-
nomique perceptible notamment en Mésopotamie et dans les anciennes pro-
vinces byzantines.
Jusqu’à la fin du xi
e
siècle, les marchands byzantins et musulmans dominent
les activités commerciales dans le bassin méditerranéen. L’essor du commerce
dans le monde musulman, qui a conservé une forte activité marchande, est mis
en évidence non seulement par les sources arabes et les recherches archéologiques,
mais aussi par les documents de la Genizah du Caire étudiés par Goitein, qui
révèlent également le rôle de premier plan des marchands juifs aux côtés des
hommes d’affaires musulmans. Ils ont construit un réseau de relations s’étendant
de la péninsule Ibérique jusqu’à la Syrie, en passant par le Maghreb, l’Égypte
et la Sicile. L’accroissement des activités marchandes est lié au développement
urbain spectaculaire qu’a connu le monde musulman, avec l’extension d’an-
ciennes agglomérations comme Damas, Alexandrie ou Cordoue et la fondation
de nouvelles villes telles que Bagdad, Fustât-Le Caire, Kairouan, Marrakech ou