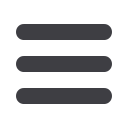Échanges commerciaux
415
règles édictées dans les ports et cités indépendants : le vin réputé de Thasos fait
l’objet d’une réglementation que certains qualifient de « protectionniste », la
cité de Délos contrôle le commerce du charbon et du bois, denrées rares en
mer Égée ; comme nombre de cités au iii
e
siècle, l’État rhodien fait timbrer les
amphores de vin à l’exportation…
En Méditerranée occidentale, l’ouverture de Rome au monde extérieur, l’ac-
tivité des
negotiatores
qui précèdent souvent les conquêtes militaires, l’afflux
monétaire qui est la conséquence de ces dernières, l’accroissement des besoins
poussent Romains et Italiens à se lancer dans de grandes opérations commer-
ciales. L’évolution vers une économie d’échanges est un des traits nouveaux
de l’économie romaine à partir de la seconde moitié du iii
e
siècle. av. J.‑C. Les
témoignages matériels des échanges révélés par l’archéologie montrent la mise
en place de routes commerciales qui sillonnent la Méditerranée. Les fouilles
sous-marines, notamment, ont mis en évidence l’existence de navires chargés
de milliers d’amphores à vin destinées à étancher la soif gauloise, qui entraîne
d’énormes profits et incite tout un pan de l’agriculture italienne à produire le
vin transporté par les marchands italiens jusque dans les ports de redistribution,
Marseille, Arles et Narbonne, avant de remonter les fleuves par capillarité. On
a pu ainsi calculer à un million par an le nombre d’amphores à vin exportées
depuis l’Italie, en majeure partie depuis la côte tyrrhénienne, vers la Gaule. Mais
le vin est loin d’être le seul objet du commerce et il ne faut pas négliger les autres
marchandises qui génèrent de grands profits comme les métaux, ou encore les
esclaves achetés au marché de Délos, port franc où les
Romaioi
étaient installés
en nombre, et qui étaient ensuite revendus en Italie.
À partir de l’époque césarienne et surtout de l’avènement de l’Empire, l’échelle
des échanges subit une accélération. Le débat opposant primitivistes et moder-
nistes a longtemps masqué une réalité complexe et diversifiée. Parcellaire, iné-
gale, autorisant des interprétations contradictoires, la documentation explique
que les débats aient sans cesse été relancés depuis le xix
e
siècle. Les travaux
récents, en soulignant l’importance des productions commercialisées et l’évolu-
tion des échanges en Méditerranée, semblent cependant contredire l’hypothèse
d’un « énorme conglomérat des marchés interdépendants », selon l’expression
de Peter Temin (2011). Ces sources archéologiques doivent cependant être
convoquées avec prudence, car elles sont fragmentaires : la céramique y est sur-
représentée, tandis que les produits périssables sont presque totalement absents.
Il est nécessaire par ailleurs de différencier les produits de consommation cou-
rante et ceux qui font l’objet d’un commerce de luxe ou ponctuel, puisqu’ils ne
reposent pas sur la même demande. La question du mode de distribution doit
elle aussi être envisagée : si l’on a récemment eu tendance à réévaluer le transport
par voie terrestre, l’essentiel des marchandises, notamment les plus pondéreuses,