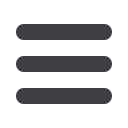Navigation
1072
cette direction. L’évaluation de la direction, déterminant le cap du navire, s’effec-
tue d’après la direction des vents, dont on connaît la portée, et est contrôlée par la
position des astres. L’estime de la distance parcourue était exprimée en journées
de navigation : journée diurne de 17 heures au solstice pour les trajets courts ;
journée de 24 heures pour les trajets longs comportant une navigation nocturne.
Pour les besoins des géographes, ces durées ont été traduites en distances et esti-
mées, selon Hérodote (IV, 85‑86), à 700 stades pour une journée de 17 heures de
navigation par vent favorable, ou à 1 000 stades pour 24 heures. Mais cela dépend
évidemment des performances du navire et Marcien d’Héraclée considérait que
l’estimation moyenne de 700 stades pouvait varier de 500 à 900 stades selon la
qualité du bateau. Enfin, en raison de la relative imprécision de cette navigation
à l’estime, la traversée s’achevait à nouveau par une navigation côtière jusqu’au
port de destination finale. Le moment de l’arrivée sur la côte était alors redouté,
surtout dans les zones de hauts fonds ou de récifs, et l’usage de la sonde – sans
doute le seul véritable instrument de navigation utilisé dans l’Antiquité et dont la
présence est attestée sur de nombreuses épaves – pouvait se révéler indispensable.
Le navire est un facteur déterminant de la navigation antique. L’étude des
épaves montre que les carènes pouvaient avoir des formes évoluées qui favori-
saient les performances nautiques et l’on sait que le gouvernail latéral antique
était sensible et efficace. Quant au gréement, il est fondamentalement composé
d’une voile carrée (c’est-à-dire perpendiculaire à l’axe du navire) d’une grande
souplesse d’utilisation. L’apparition, à partir du v
e
siècle av. J.‑C., sur les navires
de commerce d’un second mât sur l’avant va améliorer l’équilibre du navire et
en faciliter les évolutions. La voile latine (triangulaire), en revanche, ne semble
apparaître que sous l’Empire romain et reste exclusivement réservée aux petits
navires et à la pratique de la navigation côtière. Aussi, les traversées loin des
côtes s’effectuent essentiellement aux allures portantes (du vent arrière au vent
de travers) qui correspondent à la plus grande efficacité de la voile carrée. Et si
le navire antique pouvait au besoin remonter légèrement au vent et louvoyer,
ces allures restaient exceptionnelles et n’étaient utilisées que pour entrer ou sor-
tir d’un port, chercher un vent favorable ou gagner un abri. En raison des vents
dominants, les trajets aller et retour des traversées s’effectuaient par des routes
différentes, sans parler des détournements fréquents imposés par le mauvais
temps. Ainsi par exemple, si le voyage de Rome à Alexandrie se faisait en ligne
directe depuis la sortie du détroit de Messine grâce aux vents établis de nord-ouest, le voyage de retour s’effectuait le plus souvent en contournant ces vents
par le nord, en passant par la côte anatolienne, la Crète et la Grèce, non sans
risques comme le montre le voyage de saint Paul de Césarée à Rome (Actes des
Apôtres, XXVII, 1‑44) [planches XIII et XIV]. Pourtant, dans des conditions
de vent et de mer favorables, les traversées s’effectuaient à des vitesses moyennes de