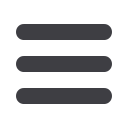Échanges commerciaux
429
locaux. Les muletiers rencontrés par Don Quichotte sont souvent accusés d’être
des agents de ce bouleversement du « bonheur public ».
Cette image de déséquilibre des flux doit être comparée à un autre élément fon-
damental du grand récit : l’image d’ordonnancement des pouvoirs, même s’il est
souvent violent et conflictuel. La Méditerranée n’a rien à voir avec l’idée de
Mare
Liberum
proposée par Hugo de Grott au début du xvii
e
siècle. À la différence
des océans, qui étaient des mondes sans frontières et sans loi, la Méditerranée
a souvent été conçue comme un « territoire »
; et, en tant que tel, son moment
de plénitude, sur le plan de la civilisation comme sur celui des trafics, a été rap-
porté aux siècles où la mer était
nostrum
, car
clausum
, entourée d’un anneau de
terres caractérisé par une domination et une civilisation homogène : les siècles
de l’Empire romain. Avant et après, elle se présente comme un territoire mar-
qué par de gigantesques dualismes de dominations et de civilisations : Grecs et
Barbares, chrétiens et musulmans, Européens et Ottomans, habitants de la rive
nord et ceux de la rive sud. Il en ressortira des rivalités irréductibles qui se sont
répercutées sur le plan économique en entravant le développement des trafics,
ou même, comme le suggère le livre célèbre d’Henri Pirenne (1937), en provo-
quant le repli rural et féodal du haut Moyen Âge européen.
Cette image d’un jeu binaire est démentie par les études de ces dernières
décennies. Les acteurs institutionnels bâtissent des alliances politiques et des
Capitulations commerciales tous azimuts – les rois de France, tout en se targuant
de la dénomination de Très Chrétiens, étaient particulièrement enclins au pacte
impie avec les infidèles ottomans. Mercantilismes et protectionnismes de tout
type produisent des normes et institutions de droit commercial, maritime et de
la navigation, suivant peu les logiques du droit romain. Étant donné l’incertitude
des frontières, ils ont une validité plus subjective que territoriale et incluent, qui
plus est, des moyens d’affaiblir leur nature coercitive. Il suffit de se référer à la
question toujours brûlante du « droit de visite », c’est-à‑dire la tentative systé-
matique d’empêcher les officiers du pays avec lequel on commerce de visiter les
cales de ses navires marchands, pour permettre en réalité des opérations que les
accords qualifient d’« illicites ». Ainsi, du monde institutionnel, la promotion de
son « commerce actif » – entendu comme solde positif de la balance commerciale,
contrôle de la navigation et échange de produits manufacturés contre des den-
rées – descend souvent au niveau de l’action quotidienne de consuls, douaniers,
officiers chargés de la santé maritime
: les archives pullulent de plaintes virulentes
pour les harcèlements
réciproques, plutôt que pour l’iniquité des normes écrites.
Dans ce contexte, le concept de fraude commerciale doit être revu. Le mot
« contrebande », très répandu dans la langue des échanges méditerranéens, se réfère
à un ensemble de pratiques – de l’utilisation des drapeaux multiples à la fréquen-
tation des « ports ruraux », en passant par les fausses déclarations sur le poids ou