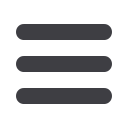Échanges commerciaux
427
français à partir de la seconde moitié du xvii
e
siècle, toutes prennent part aux
grandes transformations qui, à partir de la fin de l’époque moderne, bouleversent
les savoirs et les outils de la production et de l’échange. La révolution des trans-
ports maritimes de la seconde moitié du xix
e
siècle, avec l’arrivée des bateaux
à vapeur et l’ouverture du canal de Suez, investit également la Méditerranée.
Mais les événements essentiels surgissent et se déroulent désormais ailleurs. Cette
vieille fascination pour les grands siècles de l’échange, ceux de l’époque classique
et ceux à cheval entre le bas Moyen Âge et le début de l’époque moderne, resurgit
toutefois dans l’historiographie du xx
e
siècle, en proposant de nouveau l’image
stéréotypée de la civilisation marchande méditerranéenne comme berceau d’une
civilisation économique occidentale, menacée par des barbaries anciennes et nou-
velles, mais destinée à triompher.
C’est l’un des grands récits qui structurent la mémoire européenne et occi-
dentale. Dans le contexte de la mondialisation actuelle, la tentation de durcir et
d’utiliser le récit pour renforcer une identité menacée se fraie un chemin jusque
dans l’historiographie professionnelle. Mais ici, cette historiographie se mesure
avec la tendance opposée qui consiste à compliquer le récit. Le regard se décen-
tralise en faisant apparaître au premier plan des hommes et des lieux laissés trop
longtemps dans l’ombre. La Méditerranée prend le visage d’une mer grouillant
de marins, marchandises et navires qui pénètrent dans des coins reculés dont les
toponymes ne sont pas toujours reportés sur les cartes de géographie.
Les sociétés locales méditerranéennes, comme on l’a dit, ne se regroupent pas
dans des microespaces autosuffisants, selon le modèle nord-européen de l’auto-
consommation rurale. Le risque alimentaire concerne non seulement les villes,
mais aussi les campagnes, y compris les campagnes céréalières, et contribue à les
projeter dans le monde des échanges commerciaux. D’ailleurs, cette projection
marchande ne crée pas des complémentarités économiques stables. Le pay-
sage rural produit un éventail limité de denrées : c’est la célèbre « trilogie médi
terranéenne », blé, huile et vin, qui, avec la laine des moutons transhumants et,
à partir du début de l’époque moderne, la soie « copiée » sur les Chinois, consti-
tue à la fois une bénédiction et une malédiction pour les producteurs. La variabi-
lité des récoltes et la fluctuation de la demande peuvent en effet provoquer une
succession d’années de disette et d’autres durant lesquelles les marchandises pour-
rissent dans les entrepôts du fait de l’absence d’acheteurs. Les complémentarités
entre les sociétés côtières sont donc souvent faibles, et doivent être recherchées
laborieusement à travers une activité très poussée, minutieuse et quotidienne,
sur des marchés qui, même pour ces denrées de base, peuvent être éloignés dans
l’espace physique et culturel. Parallèlement, les marges de flexibilité du paysage
agricole doivent être totalement exploitées. Paysage qui, malgré les rhétoriques
de la Méditerranée éternelle, est tout sauf immobile : sous l’impulsion d’une