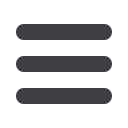Navigation
1081
de la marchandise transportée ; frais inhérents à la navigation ; droit du capi-
taine ; durée du voyage ; taxes pour temps de chargement dépassé (surestarie) ;
existence ou non de fret de retour pour les bâtiments qui cherchent à éviter une
circulation sur lest (à vide).
La Méditerranée, présentée traditionnellement comme excentrée sinon mar-
ginalisée des circuits économiques après les grands voyages de la fin du xv
e
siècle,
reste fortement fréquentée au cours de la période moderne, y compris par les
bâtiments venus de la façade ponantaise. Alors que la navigation méditerra-
néenne est au cours de la période médiévale essentiellement le fait de bâtiments
et d’armateurs méditerranéens – Vénitiens et Génois franchissent néanmoins le
détroit de Gibraltar en direction de la mer du Nord –, elle devient, de manière
croissante, à partir du xvi
e
siècle, aussi le fait de bâtiments non méditerranéens :
anglais, hollandais puis « nordiques » (danois, suédois) en direction des échelles
du Levant avec quelques étapes majeures qui sont autant d’entrepôts à l’instar
de Livourne, ce « Levant rapproché » (Braudel et Romano).
Comme dans les périodes antérieures, mais de manière moins soutenue à la fin
de l’époque moderne, le choix de la route résulte d’une « alchimie complexe » ;
c’est une « synthèse des exigences des usagers (marins, marchands, voyageurs),
de leur rapport de pouvoir, de la connaissance du milieu » (Arnaud, 2005). Si
les décisions appartiennent en apparence au capitaine aux compétences affir-
mées, celui-ci peut se trouver en réalité sous l’étroite dépendance, y compris pour
le choix de l’itinéraire, d’une autre personne embarquée : le subrécargue, qui
représente les intéressés à la cargaison, le second, voire le lieutenant. De telles
consignes et responsabilités sont précisées au départ du navire, dans un acte nota-
rié ou sous seing privé, entre membres de la société ou compagnie.
Une campagne de cabotage lointain peut également débuter par un petit
cabotage pour constituer le chargement ou l’approvisionnement du navire et se
terminer par un semblable « piétinement » côtier afin de redistribuer une partie
des marchandises. Dans cette navigation se combinent des opérations complexes
délicates à débusquer : navigation à fret, commerce et prêts, avec des réparti-
tions, tout aussi complexes, des profits ou pertes « campagne après campagne »
et « à retour de voyage ». La durée de ces navigations est très variable et dépend
d’une série de paramètres en dehors des contraintes naturelles signalées. Pour les
voyages en droiture, aller de Marseille à Smyrne, Alexandrie ou Constantinople
demande 18 à 35 jours et 22 à 42 jours pour les retours en charge au xvii
e
siècle.
Dans la navigation « à la cueillette », les campagnes peuvent excéder les deux
années réglementaires : les prétextes déclarés sont alors nombreux pour expli-
quer les « congés surannés » (quarantaines, forbans, fret à constituer, vents
contraires, avaries…) et peu sanctionnés malgré la sévère législation à cet égard.
Ces durées – on ne raisonne pas en vitesse – sont plus longues lors des conflits