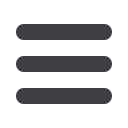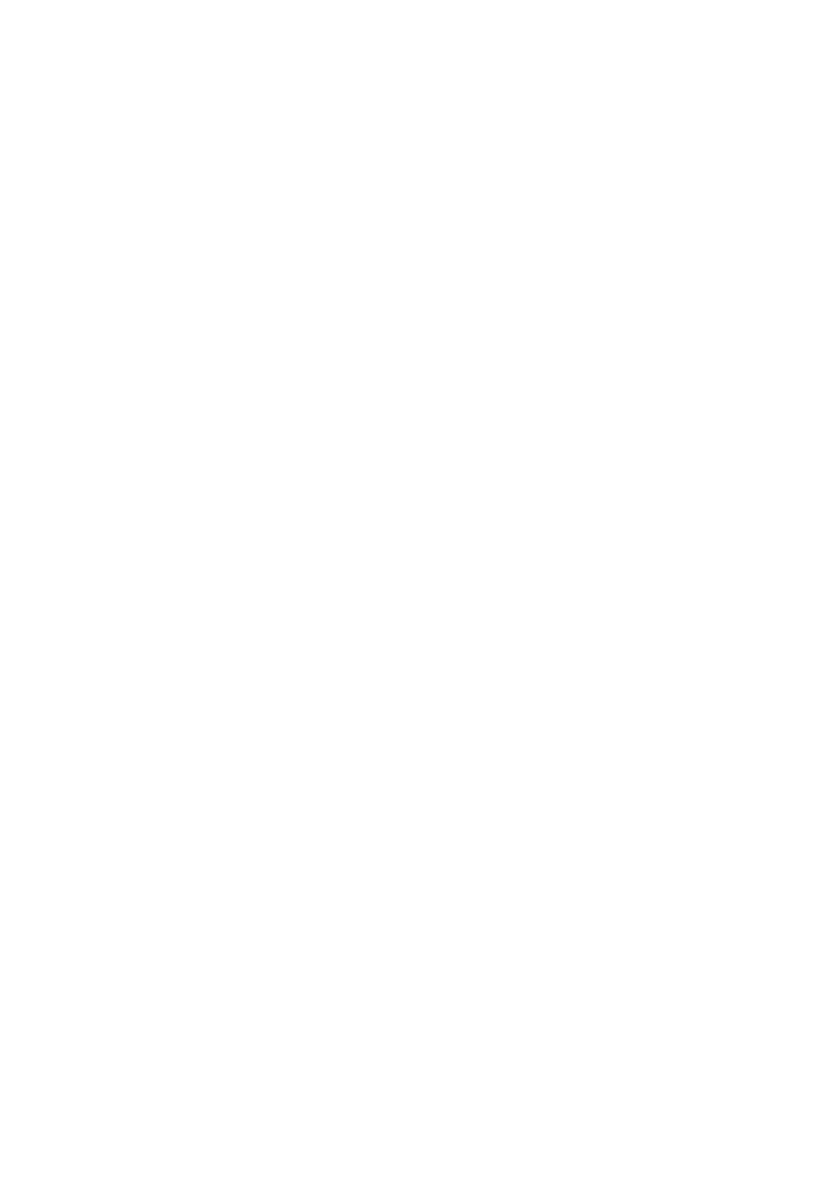
Navigation
1080
À côté des trafics à court rayon, et parfois en complément de ceux-ci, il existe
un cabotage lointain sinon « cabotage au long cours ». Les navires qui vont « en
droiture » empruntent des routes maritimes relativement régulières. Ainsi, au
départ de Marseille ou de Gênes, en direction des Échelles du Levant, on suit
la côte italienne, on gagne la Sicile, puis on traverse la mer Ionienne en direc-
tion de la Morée. Là, les routes se divisent en trois branches : l’une, au nord, per-
met de gagner l’Archipel (Cyclades), Smyrne ou Constantinople ; une autre, au
sud, longe la Crète, permettant par Rhodes d’atteindre Chypre, la côte syrienne
et l’Égypte ; et une dernière, de parvenir à Alexandrie directement à partir de la
Crète. À cette navigation directe ou « réglée » vers le Levant, il faut ajouter une
technique originale d’armement, à savoir le « voyage en caravane », « à l’aventure »
ou encore « à la cueillette ». Cette pratique est attestée dans le bassin occidental
de la Méditerranée depuis le xvi
e
siècle au moins, à partir de Livourne, Gênes,
Barcelone, Marseille ou Agde. Toutefois, cette navigation connaît un vif essor
dans la seconde moitié du xvii
e
siècle dans le monde arabo-musulman dont les
flottes marchandes sont insuffisantes pour assurer, en toute sécurité, les liaisons
entre les différentes provinces de l’Empire. Il s’agit non pas d’un déplacement en
groupe ou en convoi, ainsi que pourrait le suggérer le terme « caravane », mais
d’un
tramping
ou cabotage lointain, qui n’est pas sans rappeler le « commerce
d’Inde en Inde » pratiqué par les Européens au même moment dans le monde
asiatique. Les Français n’ont certes pas l’exclusivité de ce mode de navigation
légalisé par La Porte, c’est-à-dire le gouvernement ottoman, en 1686. Des mar-
chands italiens et ragusains s’y livrent également, mais les Provençaux dominent
cette navigation jusqu’au dernier quart du xviii
e
siècle. Les négociants marseil-
lais comme les marchands des petits ports voisins (La Ciotat, La Seyne, Saint-Tropez, Cannes, Antibes) arment et vont en caravane ; selon une estimation
basse, établie par la chambre de commerce en 1786, « chaque année revenait
à Marseille une centaine de caravaneurs ». En vertu des règlements édictés par
les bureaux de Versailles, le capitaine caravaneur recevait un congé de deux ans
pour se livrer à ce grand cabotage qui, par la durée et la distance globale parcou-
rue, pouvait s’apparenter au long cours. Plus complexes, quelques expéditions
caravanières associent parfois les deux bassins de la Méditerranée tandis que
d’autres débutent par une campagne sur les côtes du Ponant avant d’aller dans les
eaux de la Méditerranée arabo-musulmane comme le fait la corvette
Benjamin
,
de Marseille, qui effectue un voyage vers Le Havre en juillet-août 1763, avant
d’aller au Levant en caravane d’octobre 1763 à janvier 1765, après avoir effec-
tué une escale à Cadix sans trouver de fret (planche XVI).
Le choix du type de navigation repose en général sur sa compétitivité en
termes de prix, mais son coût appelle de complexes calculs qui intègrent un
ensemble de paramètres : prix à l’unité de poids, de volume ou de conditionnement